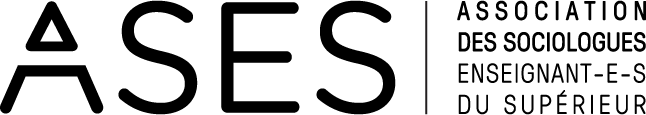Pourquoi la sociologie n'a pas (encore ?) fait sa révolution féministe
Artemisa Flores-Espínola
ATER docteure à Paris 8-CRESPPA-CSU
Si l’on constate un intérêt très marqué pour les recherches sur la place des femmes et le genre dans le monde francophone (e.g., dans les congrès internationaux de la recherche féministe francophone) et s’il existe, notamment en France, diverses structures chargées de dresser un état des lieux en la matière (e.g., la Mission pour la place des femmes au CNRS, le Recensement national des recherches sur le genre, l'Institut du genre), ces recherches restent marginales (Jacquemard et al., 2012). Par exemple, au cours des 25 dernières années, l’une des revues « généralistes » anglaises en sociologie du travail a publié cinq fois plus d’articles sur le genre que son homologue française (Le Feuvre et al., 2013). De par leur objet qui, précisément, est d’analyser la place des femmes et des études sur les femmes et le genre dans les institutions scientifiques, les études féministes des sciences sont traditionnellement les premières pourvoyeuses de recherches sur les femmes et le genre dans les disciplines. Et comme elles restent très rares en France (Pfeiffer, 2000) et méconnues dans nos disciplines, il n’est pas surprenant de constater la place secondaire de ces recherches dans nos champs.
Les études féministes forment un champ interdisciplinaire très dynamique qui permet de revisiter les concepts, méthodes et objets des disciplines traditionnelles. L’objectif de cet article est de mettre en exergue les spécificités des études féministes ainsi que leurs contributions aux sciences, dans un contexte particulièrement difficile de repli relatif, observé dans les publications des sciences et techniques, de la participation des femmes et du nombre de travaux publiés sur le genre. Les résultats de ma recherche doctorale sur les méthodologies féministes dans le champ des sciences et techniques indiquent en effet que la participation des femmes à trois des plus prestigieuses revues de ce domaine (Social Studies of Science, Science, Technology & Human Values et Technology & Culture) comme le nombre de travaux portant sur le genre publiés dans ces revues, diminuent depuis les années 2000 après avoir connus une augmentation constante et progressive entre les années 70 et la fin des années 90. Récemment, j’ai montré que cette baisse, observée de 2000 à 2005, n’était pas strictement conjoncturelle et constituait une véritable tendance. (Flores-Espínola, 2016)[1]. Les résultats sont pour le moins inquiétants en ce qu’ils sont de nature à remettre en cause la consolidation et l’institutionnalisation de cette participation croissante des femmes depuis les années 1970. Il reste toutefois nécessaire, pour mesurer l’étendue de cette tendance observée dans les études de Science, Techniques et Sociétés (STS)[2], de voir si on la retrouve dans d’autres disciplines.
Les recherches du champ « science, technologie et genre » (STG) étudient les relations entre les sexes, la science et la technologie. Elles proviennent d’un double mouvement : l’entrée massive des femmes dans le monde scientifique avec la seconde vague du féminisme et l’introduction du féminisme dans le monde académique. Le champ des études STG, également interdisciplinaire, a contribué à renouveler profondément les disciplines des sciences humaines et sociales depuis quarante ans en transformant radicalement leurs objets, leurs questions de recherche et leurs manières de voir.
Sandra Harding, dans son livre The Science Question in Feminism[3], souligne qu’au milieu des années 70, les critiques féministes sont passées d’une posture réformiste à une posture révolutionnaire. Les premiers travaux réformistes ont d’abord entendu faire progresser la science existante mais, peu à peu, les critiques se sont attelés à en transformer les fondements. Autrement dit, les critiques ont commencé à poser la question de la « femme dans la science » pour ensuite poser celle de la « science dans le féminisme » qui pourrait être formulée comme suit : « est-il est possible d’utiliser à des fins émancipatrices des sciences qui se trouvent intimement liées et manifestement immergées dans les projets occidentaux, bourgeois et masculins ? » (Harding, 1986 : préface).
Dans le présent article, on suivra le développement des travaux scientifiques à l’aune de cette évolution identifiée par Sandra Harding en 1986 (de la question de la femme dans la science à celle de la science dans le féminisme). Une évolution dont il convient de préciser, la question de la femme dans la science restant pleinement pertinente, qu’elle correspond davantage à une extension plutôt qu’à un déplacement du champ problématique. Pour évaluer l’ampleur de la « révolution » que les féministes ont impulsée, je prendrai l’exemple de la sociologie.
Pourquoi si peu de femmes dans les sciences ?
L’entrée massive des femmes à l’université et la transformation du féminisme en mouvement académique ont conditionné le développement des études sur le genre dans les sciences. C’est dans le cadre de ces deux mouvements ayant de façon conjuguée impulsé une évolution des différents champs disciplinaires, que les femmes scientifiques, et en particulier en philosophie et sociologie, se sont attelées à expliquer les effets du genre dans la pratique scientifique.
L’entrée des femmes en science s’est faite progressivement mais c'est à partir de 1960 qu’elle s’opère de façon plus massive et significative. A cet égard, la publication de l’article d’Alice Rossi en 1965 « Pourquoi si peu ? » dans Science, qui fait référence aux effectifs de femmes dans la science, fut le déclencheur d’une série de programmes de recherche sur le thème des femmes dans la science. Les premiers travaux menés sur les femmes dans l’histoire des sciences et technologies ont révélé à quel point ces dernières ont pu être « invisibilisées » (Rossiter, 1982 ; Schiebinger, 1999 ; Rose, 1994). L’identification dans ce cadre des obstacles structurels à l’accès des femmes à la connaissance, depuis la création des universités et l’institutionnalisation postérieure de la science par la création des académies des sciences, a été de la plus grande importance. Si les mécanismes de discrimination sont longtemps restés explicites, ils sont aujourd’hui beaucoup plus implicites (discrimination territoriale, hiérarchique et contractuelle). De surcroît, les travaux montrent maintenant que les barrières structurelles dans le monde académique, telles que le « plafond de verre », ou plutôt le « ciel de plomb » (Laufer, 2004 ; Buscatto et Marry, 2009), ainsi que les disparités entre les sexes en termes de publication, peuvent être expliquées par des « formes subtiles de discrimination » (Katila et Meriläinen, 1999) ou comme résultant des « mécanismes cachés de la domination masculine ». Les données collectées dans le livre blanc pour Le genre dans l’enseignement supérieur et la recherche (2014) nourrissent largement ce constat (pour des éléments de précision et de nuance, voir également le texte d’Olivier Martin dans ce bulletin).
Devant ces barrières, obstacles et mécanismes de discrimination qui empêchent toute égalité d’accès au travail scientifique, des critiques féministes de la science se sont développées (qui quelque temps plus tard s’étendront aussi à la technologie). Les premières critiques sont d'abord intervenues dans le champ des sciences humaines et sociales en vue d'analyser ce qui pouvait se dire des femmes, de documenter leurs contributions dans les différents champs disciplinaires et de « débusquer » les mécanismes perpétuant leur subordination et leur marginalisation (Flores, 2013). Dans ce cadre, les travaux à caractère historiographique visant à faire sortir de l’oubli les femmes ayant contribué à la science (Sayre, 1975 ; Alic, 1986 ; Schiebinger, 1987) ou constatant simplement à quel point nombre d'entre elles avaient pu œuvrer scientifiquement en marge de la communauté scientifique (Rossiter, 1988) ont revêtu une importance particulière. Les premières critiques féministes en histoire se sont portées sur la façon dont l'historiographie pouvait ignorer des interactions humaines aussi fondamentales que celles entre les sexes (Smith Rosenberg, 1975). Parmi ces critiques, il convient par exemple de relever celle de l'historienne Joan Kelly Gadol qui remit en cause la façon de périodiser l'histoire en en proposant une nouvelle sur la base des deux assertions suivantes : 1) les femmes forment un groupe distinct et 2) l'invisibilité de ce groupe ne saurait être imputée à la nature des femmes. Dans son célèbre article « Did Women Have a Renaissance ? » (Kelly-Gadol, 1977), l'auteure pointe les limites analytiques des propositions éludant le sexe en tant que catégorie d'analyse et répond négativement à la question qu'elle pose, renversant alors la vision contemporaine de la Renaissance et de l'historiographie.
Si l’intérêt des critiques féministes s’est d’abord porté sur l’histoire, il s’est cependant ensuite rapidement étendu à d’autres sciences, en particulier à celles qui, de par les théories qu’elles recouvrent, explorent la sexualité ou le comportement des sexes. Par exemple en primatologie où, dans la théorie de l’homme-chasseur (Bleier, 1984), les biais androcentriques font que le développement évolutif humain est presque exclusivement appréhendé à travers l'activité des mâles. Les exemples sont également nombreux en archéologie (Hays-Gilpin et Whitley, 1998), en médecine (Verbrugge, 1976 ; Löwy, 2005), en psychologie (Parlee, 1975, 1979). Ces critiques sont apparues précisément lorsque les scientifiques des sciences naturelles ont commencé à repérer des biais et tenté de les ‘corriger’ ou de les ‘éliminer’. Elles se sont caractérisées par le fait que leurs auteures ont cru un temps en la possibilité d’éliminer de tels biais sans remettre en cause la structure épistémique sous-jacente. Les femmes scientifiques ont toutefois pu constater que certains travaux biaisés ne constituaient pas de la « mauvaise science » en ce sens qu'ils ne méconnaissaient pas les principes méthodologiques de la recherche scientifique et qu'au contraire, ils respectaient tous les standards d'un travail scientifique rigoureux (Anderson, 2011). Dès lors, les chercheuses féministes ont mobilisé ces biais de la science « normale » comme ressources pour développer des approches alternatives sur le plan épistémologique, avec quelques exemples paradigmatiques (Haraway, 1989 ; Harding, 1986, 1991, 1993, 1998 ; Lloyd, 2006 ; Longino & Doell, 1983 ; Schiebinger, 1989 ; et Wylie, 1996).
Les « sœurs fondatrices » en sociologie
Le corpus théorique du féminisme a permis une production de savoir-clés sur quelques figures féminines marginalisées comme celle d’Annie Marion MacLean (1870-1934), considérée comme la fondatrice de l’ethnographie moderne et pionnière de la sociologie par correspondance (Garcia Dauder, 2008), et dont les recherches procèdent de l’observation participante. Elle-même travailla pendant de courtes périodes comme simple employée ou ouvrière dans divers milieux : grand magasin, atelier de misère, exploitation agricole, usine. Maclean trouvait qu’il était primordial de connaître la réalité de ces femmes, leurs expériences, « de l’intérieur ». Elle refusait de parler au nom des travailleuses et leur laissait le soin de raconter leur propre expérience. Mais elle a également fait de sa propre expérience subjective une ressource pour raconter la réalité qu’elle a pu partager avec les travailleuses. Et ce toujours depuis une position située et dans la reconnaissance de ce que sa condition difficile de travailleuse, dans les usines, était le résultat d’un choix qu’elle s’imposait contrairement aux autres travailleuses, contraintes de subir cette situation. Marie Jo Deegan, dans son livre Women in sociology[4], identifie cette période comme « l’ère dorée des femmes en sociologie » (1991). Parmi les figures féminines de l’ « Ecole de Chicago des femmes », nous connaissons Jane Addams, Marion Talbot, Florence Kelly, Julia Lathrop, Frances Kellor, Edith Abbott, Sophonisba Beckinridge, Grace Abbot et Annie MacLean. Pour Lengerman et Niebrugge-Brantley (1998), le terme d’ « Ecole de Chicago des femmes de Sociologie » est utilisé pour décrire « le réseau de ces femmes qui œuvrent de façon collaborative à la production d’un corpus de sociologie unissant théorie sociale, recherche sociologique et réforme sociale ». De 1889 à 1920, ces femmes se trouvent essentiellement réparties sur deux centres : la Hull-House et l’Université de Chicago. Il faut souligner que ces social scientists ont adopté des approches interdisciplinaires à visées scientifique et réformiste, mais donnant priorité aux besoins de la société sur ceux de la recherche. Membre fondatrice de l’American Sociological Society, établie en 1905, MacLean prit également une part active à l’American Social Science Association.
MacLean a fait partie du premier département de sociologie, à l’Université de Chicago en 1892, créé par William Harper. Cependant la ségrégation sexuelle s’est traduite par la création d’un collège junior destiné aux femmes. A cette ségrégation sexuelle, s’est aussi ajoutée une ségrégation disciplinaire puisque la science sanitaire a été sortie du département de sociologie pour être intégrée au nouveau département féminin, moins prestigieux et moins doté en ressources, d’ « Économie domestique ». Ultérieurement, ce département est devenu l’Ecole de travail social. La spécialisation et la discrimination des femmes se sont également traduites par la création d’un réseau parallèle de sociologues mâles appréhendant les centres sociaux comme des « laboratoires sociologiques », et leur population comme des « objets » (Deegan, 1986) contrairement aux femmes sociologues pour qui les centres sociaux comme la Hull House recouvraient avant tout un « mode de vie ». A travers leurs articles empiriques et leurs thématiques communes sur les groupes les plus défavorisés (les femmes, les enfants, les migrantes et les pauvres), les femmes de l’Ecole de Chicago ont associé académie, recherche et activisme. Leur recherche était vouée au changement social et leur participation à la Ligue Nationale des Consommateurs visait à encourager ces derniers à prendre de bonnes décisions de consommation, c’est-à-dire à boycotter les établissements non reconnus par la ligue comme satisfaisant aux conditions de travail et d’hygiène minimales. Ces recherches et méthodes, malgré leur caractère novateur, ont été oubliées et ce en raison d’obstacles aujourd’hui bien identifiés.
L’histoire de la discipline nous rappelle que certaines femmes de l’Ecole de Chicago aux Etats-Unis sont restées aux marges et sans reconnaissance de la discipline. La théorisation de la place des femmes n’a pas été considérée comme faisant partie de la tradition sociologique et n’a pas été accueillie dans les départements contemporains. La deuxième génération de sociologues (Park et Burgues) s’est démarquée de la précédente, en revendiquant une sociologie plus scientifique qui voyait les centres sociaux comme « laboratoires sociologiques » et sa population en tant qu’objets. Selon Deegan (1991), la période courant de 1920 à 1965 représente une période noire au cours de laquelle la sociologie s’est redéfinie comme profession masculine.
Comme l’illustre le cas de Annie Marie McLean, la sociologie était il y a encore quelques décennies un monde masculin en raison du processus de professionnalisation propre à la discipline. Un constat valant également en France où l’on observe la même trajectoire d’exclusion des femmes des universités et des sociétés savantes. Fille de la révolution française et de la révolution industrielle, la sociologie ainsi que les autres sciences sociales émergent en France entre 1890 et 1940. Le féminisme, un mouvement empreint de la philosophie des Lumières, offre un contexte favorable à la pensée de l’égalité et de la contestation organisée contre l’ordre sexuel. L’accession « progressive des femmes à l’enseignement secondaire, puis supérieur, a joué un rôle important dans la légitimation de la présence de femmes dans les professions intellectuelles et dans l’affaiblissement de la croyance répandue en leur infériorité intellectuelle » (Charron, 2013 : 18). Pour Charron, la « place » occupée par les Françaises dans les sciences sociales naissantes a suscité très peu d’enquêtes sociohistoriques quand d’autres auteures suggèrent qu’il n’y a pas eu de femmes dans ce champ avant 1945. Charron montre qu’en France aussi, les femmes ont participé au groupe des sciences sociales et en particulier aux secteurs privilégiant l’enquête empirique et entretenant des liens avec la pratique réformiste. Il faut souligner qu’aucune femme n’a pu faire partie de l’Institut International de Sociologie avant la fin des années 1930. L’entrée massive des femmes en science dans les années 70 n’a pas seulement mis un terme à ce niveau de ségrégation et d’exclusion, elle a également impliqué une évolution organisationnelle de la sociologie.
Les changements structurels de la discipline
Ferré, Khan et Morimoto (2006) observent que l'afflux massif des femmes vers la sociologie a produit un processus encore à l’œuvre de reconstruction de la théorie, des méthodes et des pratiques organisationnelles, tout en relevant deux phénomènes ignorés jusque-là, le fait que « les structures sociales produisent le genre » et le fait « que les rapports sociaux de sexe façonnent les structures sociales » (Ferree et al, 2006 : p. 3). Ce processus a tout d’abord produit le renversement du concept de sex roles, dominant durant les années 1950 dans la théorie sociologique, ce qui a permis de refuser les binarités à travers « une compréhension structurale du genre » contribuant à un « analyse sociologique des inégalités en général » (Ferree et al, 2006 : p. 3). Les auteur.e.s analysent « comment les femmes sont entrées dans la discipline et ont changé les pratiques démographiques et organisationnelles de la sociologie américaine entre 1960 et 2004 » (Ibidem).
La participation politique et les mobilisations ont permis aux femmes en sociologie de légitimer une expertise dans l’étude de la vie et de l’expérience des femmes. Les « groupes de conscience » féministes apparus dans les années 1970, développant le slogan « le privé est politique », ont démontré que nombre de problèmes jusque-là cantonnés à la sphère privée, comme la violence domestique, devaient être appréhendés en tant que problèmes sociaux et mis à ce titre à l'agenda politique. D'aucunes chez les féministes ont vu dans cette démarche la base d'une méthodologie féministe, telle la sociologue canadienne Dorothy Smith (1974/1977) qui fit observer que c'est l'autorité conférée à l'expérience des femmes qui fondait le mouvement de libération des femmes. L’auteure observe que certaines caractéristiques du travail des femmes, comme le fait de prendre en charge les tâches domestiques, permettent aux hommes de disposer de temps pour se consacrer aux ‘modes d’action’ abstraits. La prise en charge de l’‘existence incarnée’ des hommes par les femmes a ainsi pour conséquence la subordination des activités domestiques et une certaine sollicitude à l’égard du travail conceptuel accompli par les hommes au sein de la société. Les hommes, qui ne réfléchissent pas à ce qui est extérieur à leur monde social et abstrait, naturalisent le travail des femmes présenté comme instinctif. Et du fait précisément de l’exclusion des activités et expériences des femmes de ce monde masculin définissant le réel, le social et l’humain, leurs perspectives ne se trouvent ni représentées ni prises en compte dans les concepts développés par les hommes. Se voyant ainsi imposer les termes et concepts à travers lesquels les hommes pensent le monde, les femmes sociologues se retrouvent de la sorte aliénées par leur propre expérience et font l’objet d’une « conscience bifurquée » (Smith 1997, p. 22). En France, l'un des premiers textes analysant les apports des minoritaires aux « théories de la société » a été publié par Colette Guillaumin (1981), qui fait observer que le fait de « devenir un objet dans la théorie était la conséquence nécessaire du fait de devenir un sujet dans l'histoire » (Guillaumin, 1981: p. 28).
Cette reconnaissance des vies et des expériences des femmes est positive mais le fait que les travaux sur le genre tendent à apparaître comme relevant de la compétence quasi-exclusive des femmes sociologues peut également sembler problématique dès lors qu’elle conforte une certaine division du travail que les hommes sociologues soutiennent – à eux les études « générales », aux femmes la question particulière des femmes – et dans laquelle les hommes sociologues ne travaillent que très rarement sur le genre. Si la majorité des recherches se focalise sans difficulté sur les hommes sans référence aucune faite aux femmes, une recherche sur les femmes qui ne se réfèrerait pas aux standards masculins ne serait pas jugée digne d’intérêt de la part des hommes (Marx Ferre et al, 2006). Ce type de ségrégation se prolonge sur le plan méthodologique, les femmes étant plus enclines à recourir aux méthodes qualitatives et les hommes plus prompts à mobiliser des méthodes quantitatives (Marx Ferre, Khan et Morimoto, 2006). Les observations aux Etats-Unis montrent également que les travaux sur le genre publiés, par des femmes ou par des hommes dans les revues dominantes de la sociologie, recourent davantage aux méthodes quantitatives (Mackie, 1985, Grant, Ward et Rong, 1987, Flores, 2013). Il va sans dire que la corrélation genre/méthode qui peut être établie ici ou là n’implique pas, loin s’en faut, l’existence de styles cognitifs essentiellement différents, et qu’elle est plutôt le produit d’une socialisation genrée initiée dès l’enfance et se prolongeant au niveau de la recherche sociologique.
Dans l’organisation structurelle de la science, les productions constituent un élément tout à fait central de la recherche. Et il est à cet égard intéressant d’observer les disparités entre hommes et femmes, en termes de publication ainsi qu’en matière d’avancement (prix, postes, promotions), qui ont constitué l’un des domaines d’exploration privilégiés par les scientifiques féministes. Si ces disparités hommes/femmes sont maintenant relativement bien identifiées, notamment en termes de publication, celles ayant trait aux choix thématiques doivent encore largement être caractérisées. Aux Etats-Unis, les hommes ont avant tout porté leur intérêt sur les sections et thèmes les plus « abstraits », généraux - théorie, méthodes, choix économiques rationnels, etc. (Marx Ferre, Khan et Morimoto 2006), dont les femmes restent largement exclues. Il serait dans ce registre également intéressant de comparer la proportion que représentent les postes qui sont occupés par des enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s par rapport à la proportion de femmes parmi les titulaires de doctorat dans la discipline. Aux Etats-Unis, la part des femmes en tenure positions dans les départements de sociologie en 1990 était équivalente à la proportion de femmes chez les docteurs entre 1950 et 1980, c’est-à-dire une femme pour quatre hommes (Marx Ferre et al, 2006)
Une inévitable révision conceptuelle
Les travaux d’Anne-Marie Devreux sont particulièrement importants pour comprendre les apports des rapports sociaux de sexe à la conceptualisation sociologique (1992, 1995, 2010 et 2016). Elle signale qu’à cet égard, la rupture féministe de déconstruction des catégories biologiques sur lesquelles fonctionnent les sciences sociales (1992) a été essentielle. En suivant Mathieu (1971), Devreux souligne « comment le traitement différentiel appliqué aux catégories de sexe en ethnologie et en sociologie (féminin=particulier, masculin=général) conduit à une impasse méthodologique et à l'impossibilité de dépasser une conception essentialiste du sexe » (Devreux, 1992 : 8). Elle met également en évidence le rapport des catégories de sexe et la nécessité de les conceptualiser comme éléments d'un système structural. La dénaturalisation réalisée par la théorie féministe montre que la « condition féminine » n'est pas socialement fixée mais qu'il existe, au sein de toute société, de tout système social, un « système des sexes » (Idem).
Les apports de Delphy et Guillaumin ont été très importants pour le développement d’une pensée féministe en sociologie. Delphy a proposé une analyse matérialiste de l’oppression des femmes. Pour elle, on trouve l’explication de cette oppression dans la structure du système patriarcal elle-même et plus précisément dans l’« appropriation naturelle de la force de travail des femmes par les hommes » (Delphy, 1998). L’identification d’un mode de production domestique permet à Delphy de parler de rapports de production qui constitueraient les hommes et les femmes en classes antagonistes. Guillaumin (1978) va plus loin en affirmant qu’il n’y a pas seulement une appropriation de la force de travail des femmes mais également une appropriation physique du corps des femmes par les hommes. Se référant à l’esclavage, Guillaumin parle d’un rapport de servage. L’auteure propose la notion de système de sexage pour rendre compte de cette logique qui ne saurait être circonscrite à la famille ou au mariage, et qui trouverait son origine dans l’appropriation d’une classe de sexe par l’autre (sexage). Par leurs travaux, les féministes ont permis de conceptualiser « la présence des rapports sociaux de sexe dans l’organisation du social sans qu'il y ait a priori prépondérance d'une seule sphère » (Devreux, 1992 : 10). Affirmer que les sexes sociaux se construisent par un rapport qui traverse l’ensemble de la société permet de saisir les logiques de reproduction sociale comme ayant pour fondement la reproduction sexuelle du travail.
Dans les années 1970, les chercheuses féministes se sont en particulier attachées à débattre du processus de travail productif. Les féministes ont mis en évidence le fait que le processus du travail, appréhendé d’un point de vue marxiste, élude un élément essentiel : le travail gratuit que les femmes accomplissent dans la sphère domestique. Comme le signale Wajcman, les sociologues féministes ont d’abord critiqué l’absence du genre dans la théorie marxiste et mis en évidence la division sexuelle du travail, en montrant que le caractère patriarcal du travail salarié se retrouvait également dans le travail gratuit que les femmes effectuent au foyer. Le thème du travail domestique suscita nombre de débats et écrits universitaires intéressants qui furent à l’origine d’une série de recherches sur le sujet.
Pour comprendre les changements de concepts comme « production » ou « reproduction » il faut prendre en compte les apports de Danièle Kergoat à la sociologie de travail. Dans l’article « Les apports de la sociologie du genre à la critique du travail », Kergoat et Elsa Galerand (2014) prennent l’exemple des ouvrières pour montrer d’abord que les rapports différenciés des hommes et des femmes au travail salarié étaient indissociables des rapports différenciés qu’ils et elles entretenaient au travail domestique. Les « ouvrières n’étaient pas seulement plus exploitées que leurs homologues masculins, mais elles l’étaient différemment et cette différence ne pouvait s’expliquer en termes de surexploitation. Car alors, comment expliquer par exemple que les ouvrières qualifiées travaillaient plus souvent à la chaîne que les ouvriers non qualifiés ? C’est bien la problématisation de la transversalité des rapports sociaux de sexe, et de leur imbrication aux autres rapports sociaux, en particulier ceux de classe, qui permettaient de répondre à ces questions et de dépasser le raisonnement selon lequel les femmes étaient exploitées suivant le mode d’exploitation domestique dans le cadre de la famille, puis simplement surexploitées sur le mode capitaliste une fois franchie la porte de l’usine » (Kergoat et Galerand, 2014).
La reconnaissance du travail domestique en tant que travail et l’effacement des frontières entre les sphères privées et publiques ont permis de questionner et de défier certaines catégories et concepts : le terme « division sexuelle du travail » a permis de penser l’intrication dynamique des rapports sociaux de sexe et de classe, leur « consubstantialité », le fait qu’ils se modulent et se configurent mutuellement et réciproquement (Kergoat, 2012). Kergoat a été l’une des premières à proposer une analyse de sexe et de classe à travers des outils appréhendant la consubstantialité des rapports sociaux et leur propriété : la coextensivité.
La division du travail n’est pas le seul exemple des concepts que l’analyse féministe a transformés. Par exemple, les travaux sur la violence domestique ont permis de déconstruire la connexion supposée naturelle entre les hommes et la violence, ouvrant le champ aux études sur les masculinités. La définition du travail et de la production, la ségrégation genrée des professions, les disparités de salaires à travail comparable entre hommes et femmes, ainsi que l’impact social de la violence envers les femmes sont des acquis en sociologie.
Les analyses sur les discriminations positives, les sexualités ou la prostitution représentent l’un des multiples chantiers d’analyses de la sociologie aujourd’hui.
Le féminisme a-t-il changé la recherche sociologique ?
Le champ professionnel de la sociologie n’est pas à l’abri des pratiques de pouvoir. Dans les années 90, Devreux a montré que les pratiques de domination masculine et la solidarité de sexe au sein de groupes d’hommes impliquait une structuration de la discipline opposant sociologie « généraliste » et sociologie féministe (Devreux, 1995). Plus récemment, Marx Ferre, Khan et Morimoto (2006) ont fait le même constat et considéré que le potentiel de transformation de la théorie féministe du genre pour une révolution féministe de la sociologie se limite à un processus politique : l’assimilation des femmes aux thématiques féministes et de genre, et des hommes au « reste » des thématiques en sociologie. Or cette double assignation des femmes à certaines sphères (famille, travail social, psychologie sociale) et des hommes aux domaines de l’abstrait tels que la théorie et les méthodes interdit quasiment toute légitimation de la théorie féministe. Les études féministes de genre restent ainsi perçues comme des niches pour chercheuses non prestigieuses.
Contrecarrant l'optimisme de certains textes des années 1970 et du début des années 1980, plusieurs voix se sont élevées, principalement dans les pays anglo-saxons, pour dénoncer non seulement les pratiques de domination au sein de la discipline mais également les résistances à l'intégration de la théorie féministe en sociologie. A cet égard, la publication aux États-Unis du célèbre article « The missing feminist revolution in sociology » in Social Problems (Stacey et Thorne, 1985) pointant ces résistances fera date au point, étant donnée la prégnance continue de la question, d'être « célébrée » vingt ans plus tard par un numéro spécial. La problématique soulevée par Stacey, avec l’avènement de la théorie du genre, a suscité tout un programme de recherches sur le processus de reconstruction des théories, méthodes et pratiques scientifiques de la sociologie.
Plusieurs auteur.e.s soulignent que la révolution féministe de la sociologie n’a pas encore vraiment eu lieu (Stacey, 1995 et 2005 ; Ferre et al, 2006). Les femmes ont certes gagné une place dans la discipline mais elles doivent continuer de se battre pour que la théorie féministe soit reconnue et considérée dans la recherche. Aujourd’hui la théorie féministe reste marginalisée et la grande majorité des collègues continue de développer leurs travaux sans considérer ces approches.
L’exclusion en sociologie des concepts et méthodes utilisés par les études féministes ou de genre peut être observée à l’aune des publications du courant dominant de la discipline. Un tel travail n’a pas encore été réalisé sur les publications francophones, mais d’après les résultats de mes recherches sur les publications anglophones en science et techniques (2013), on observe que l’influence du féminisme sur la période 1996-2000 était plus importante qu’elle ne l’est aujourd’hui et que les travaux féministes ou sur le genre revêtaient alors une importance plus forte. 36% des articles comprenaient par exemple des citations empruntées à la théorie féministe du genre[5]. Mais déjà sur la période 2000-2005, on observe un léger recul de cette valeur. Les résultats de travaux sur les publications en sociologie montrent que la théorie féministe n’est pas considérée comme un aspect de la théorie sociologique contemporaine. Delamont (1987) affirmait que « les histoires et la vue de l’ensemble des grand récits de sociologie ignoraient les femmes et le féminisme depuis 30 ans et continuent à le faire ». Il n’y a pas si longtemps, Johanna Siméant demandait publiquement pourquoi les associations professionnelles ne prendraient-elles pas position contre la tenue de jurys de thèse (et colloques ou autres événements scientifiques) monosexués ? Il faudrait réfléchir à la forme que pourrait prendre une réaction publique des associations. Il semble claire qu’il reste beaucoup à faire pour que se réalise la révolution féministe en sociologie.
Les études « sciences, techniques et genre » ont revêtu une importance croissante durant ces dernières décennies, particulièrement pour l’analyse de la place des femmes dans les sciences et professions, mais également pour l’offre d’un cadre interdisciplinaire permettant d’évaluer les apports conceptuels, méthodologiques et épistémologiques des études féministes dans notre discipline. Malgré une certaine reconnaissance dans le champ STS, l’importance de la théorie féministe n’est toujours pas pleinement reconnue et la prise en considération de ces études dans le champ des études STS reste partielle.
Références
Alcoff, Linda y Elizabeth Potter (eds.) (1993). Feminist epistemologies, New York: Routledge.
Alic, Margaret (1991), El Legado de Hipatia. Historia de las mujeres de ciencia desde la Antigüedad hasta el Siglo XIX, Madrid: Siglo XXI.
Anderson, Elizabeth. (1995). « Feminist Epistemology: An interpretation and a defense », Hypatia 405, No. 3, pp. 50-84.
— (2011). « Feminist Epistemology and Philosophy of Science », The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/feminism-epistemology/>.
Association Nationale des Études Féministes (2014) Le genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, La Dispute (collection « Le genre du monde »), Paris.
Bleier, Ruth (ed.) (1986), Feminist Approaches to Science, New York: Pergamon Press.
— (1984), Science and Gender. A Critique of Biology and Its Theories on Women. New York: Pergamon Press.
Buscatto Marie et Catherine Marry (2009). « Le plafond de verre dans tous ses éclats : La féminisation des professions supérieures au xxe siècle », Sociologie du travail, Vol. 51, pp. 170–182
Chabaud-Rychter, Virginie Descoutures, Anne-Marie Devreux, Eleni Varikas (dir.) (2010), Sous les sciences sociales, le genre. Relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour, La Découverte, coll. Sciences Humaines.
Daune Richard, Anne Marie et Anne Marie Devreux (1992). « Rapports sociaux de sexe et conceptualisation sociologique », Recherches féministes, Vol. 5, nº 2, p. 7-30.
Daune-Richard Anne-Marie et Anne-Marie Devreux (1985), « La construction sociale des catégories de sexe », Bulletin d’information des études féminines, n° 17, 39-54.
Deegan, Mary Jo (1991). Women in sociology, A bibliographical Sourcebook. Westport, CT : Greenwood Press.
__ (1986). Jane Adams and the Men of the Chicago School, 1892-1928. New Brunswick : Transaction Books.
Delamont, Sara (1987). « Three Blind Spots? A Comment on the Sociology of Science by a Puzzled Outsider », Social Studies of Science, Vol. 17, No.1, pp. 163-170.
Delphy, Christine (1998) L'ennemi principal : économie politique du patriarcat, Paris : Syllepse,
(1970). « L'ennemi principal », Partisans, 54-55 : pp.112-139.
Devreux, Anne Marie (2016). Sciences et le genre, Presses Universitaires de Rennes, à apparaitre.
__ (1995). « Sociologie "généraliste" et sociologie féministe: les rapports sociaux de sexe dans le champ professionnel de la sociologie », Nouvelles Questions Féministes, Vol. 16, nº. 1, pp. 83-110.
Ferree, Myra Marx et al, (2006). « Assessing the feminist revolution: The presence and absence of gender in theory and practice », en Craig Calhoun (ed.) History of Sociology in America: ASA Centennial Volume, University of Chicago Press.
Flores-Espínola, Artemisa (2016). « ¿Los estudios CTS tienen un sexo? : Mujeres y género en la investigación académica », Revista Iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, Vol. 11, Nº 31, p. 61-92.
— (2013b), Metodología feminista: ¿una transformación de prácticas científicas?, Thèse de doctorat européen, Université Complutense de Madrid, 572 p.
— (2013a), « Science et Politique : quand le féminisme fait avancer la science » Raison Présente, No. 186, pp. 97-106.
__ (2012), « Subjectivité et connaissance : réflexion sur les épistémologies du point de vue », Cahiers du genre nº 53, p. 99-120.
García Dauder, Silvia (2008). Annie Marion MacLean : « La “madre de la etnografía contemporánea” y pionera en la sociología por correspondencia », Athenea Digital, nº 13, p. 237-246.
Gardey, Delphine (2005). « La part de l'ombre ou celle des lumières ? Les sciences et la recherche au risque du genre », Travail, Genre et Sociétés, pp. 29-47.
González García Marta I (2001). « Género y conocimiento », En: José A. López Cerezo y José M. Sánchez Ron. (eds.) Ciencia, tecnología y cultura en el cambio de siglo. Col. Razón y sociedad, Biblioteca Nueva, OEA, Madrid.
González García Marta y Eulalia Pérez Sedeño (2002). « Ciencia, tecnología y género ». Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad e Innovación. Número 2/Enero Abril, Madrid.
Guillaumin, Collette (1981) « Femmes et théories de la société : remarques sur les effets thériques de la colère des opprimées », Recherches féministes, Vol. 13, nº 2, pp. 19-32.
__ (1978) « Pratique de pouvoir et idée de Nature : 1 L'appropriation des femmes », Questions feminists, nº 2, pp. 5-30 ; 2 « Le discours de la Nature », Questions féministes, nº 3, pp. 5-28.
Haraway Donna J. (1989). Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, New York: Routledge.
Harding Sandra (1986). The Science Question in Feminism. Ithaca: Cornell University Press.
—(1991). Whose Science, Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives, Ithaca: Cornell University Press Press.
Harding, Sandra, and Merrill B. Hintikka, eds. (1983). Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science. Dordrecht, Holland: D. Reidel.
Hays-Gilpin, Kelley et David S. Withley (1998). Reader in Gender Archaeology, London: Routledge.
Huber, Joan (1976). « Sociology », Signs, Vol. 1, No. 3, pp. 685-697.
Hubbard, Ruth (1990). The Politics of Women's Biology, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
Jacquemard, Alban, Agnès Netter et Françoise Thibault (Coord.) (2012). « Egalité entre les femmes et les hommes : orientations stratégiques pour les recherches sur le genre », Paris : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 56 p. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/1340000070/0000.pdf
Katila, Saija y Susan Meriläinen (1999). « A serious researcher or just another nice girl? Doing gender in a male dominated scientific community », Gender, Work, Organization, Vol. 6, nº. 3, pp. 163-173.
Kelly-Gadol, Joan (1977). « Did women have a rennaissance? », en Renate Bridenthai et Clandia Koonz Becoming Visible: Women in European History, Houghton Mifflin Co.
Laufer, Jacqueline (2004). « Femmes et carrières : la question du plafond de verre », Revue Française de Gestion, Vol. 30, nº. 151, pp. 117-127.
Larivière, Vincent, Chaoqun Ni, Yves Gingras, Blaise Cronin et Cassidy R. Sugimoto (2013). « Bibliometrics: Global gender disparities in science », Nature News, 11 décembre.
LeFeuvre, Nicky, Pierre Bataille et Laura Morend (2013). « La visibilité du genre dans des revues de sociologie du travail. Comparaisons France et Grande-Bretagne (1987-2012) », Cahiers du genre nº 54, pp. 121-150.
Lengerman, Patricia Madoo et Nieubrugge-Brantley, Jill (1998). The Women Founders, Sociology and Social Theory, 1830-1930. Boston : McGraw Hill.
Longino, Helen (2002). The Fate of Knowledge, Princeton, NJ: Princeton University Press.
— (1993a). «Subjects, power, and knowledge: Description and prescription in feminist philosophies of science», en Linda Alcoff y Elizabeth Potter (eds.), Feminist epistemologies (pp.101-120). New York: Routledge.
— (1990) Science as Social Knowledge: Values and Objectivity In Scientific Inquiry, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Löwy, Ilana (2005). « Le féminisme a-t-il changé la recherche biomédicale ? Le Women Health Movement et les transformations de la médecine aux États-Unis », Travail, Genre et Sociétés, Vol. 14, pp. 89-108.
Marry, Catherine et Irène Jonas (2005). « Chercheuses entre deux passions: l'exemple des biologistes », Travail, Genre et Sociétés, Vol. 14, pp. 69-88.
Mathieu, Nicole-Claude (1971) « Notes pour une définition sociologique des catégories de sexe », Épistémologie sociologique, nº11, pp. 19-39.
Parlee, Mary Brown (1975). « Psychology », Signs, Vo. l.1, No.1, 119-138.
Pfeiffer, Jeanne (2000). Les débuts de la critique féministe des sciences en France (1978-1988) », in : Delphine Gardey et Ilana Löwy (coord.) L’invention du naturel : les sciences et la fabrication du masculin et féminin, Paris, Archives d’Histoire Contemporaine.
Rose, Hilary (1994), Love, Power and Knowledge. Towards a Feminist Transformation of the Sciences, Cambridge: Polity Press.
Rossi, Alice (1965). « Women in Science ¿Why so few? », Science 148, No. 3, 674. pp. 1196-1202.
Rossiter, Margaret (1993). « The Matthew Matilda Effect in Science », Social Studies of Science, Vol. 23, No.2 (Mayo): 325-41.
— (1984), Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940. Baltimore: John Hopkins University.
Sayre, Ana (1975), Rosalind Franklin y el ADN, Madrid: Horas y Horas.
Schiebinger, Londa (2001). « Has feminisme chaged science? », Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.
— (1993), Nature’s Body: Gender in the Making of Modern Science, Boston: Beacon Press
— (1989). The mind has no sex? Women in the origins of modern science, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Stacey, Judith (2006). « Feminist and Sociology in 2005: What Are We Missing? », Social Problems, Vol. 53, No. 4, pp. 479-482.
Stacey, Judith et Barrie Thorne (1985). « The missing feminist revolution in sociology », Social Problems, Vol. 32, No.4, pp. 301-316.
Verbrugge Martha H. (1976). « Women and Medicine in Nineteenth-Century America », Signs, Vol. 1, No.4, pp. 957-972.
Revue d’histoire des sciences humaines, n° 13, p. 51-68.
Waring, Marilyn (1990). If Women Counted, San Francisco: Harper Collins.
Wylie, Alison (1997), « The Engendering of Archaeology: Refiguring Feminist Science Studies », Osiris nº 12, pp. 80-99.
— (1996), « The Constitution of Archaeological Evidence: Gender Politics and Science », en Galison y Stump, pp. 311-343.
[1] Mon travail de terrain a porté sur 10 publications anglophones et intègre toutes les publications de ces revues de 1959 à 2010.
[2] L’origine des études STS remonte à 30 ans et tient d’une part au développement de nouveaux courants de recherche en philosophie et en sociologie des sciences et d’autre part à une plus grand sensibilité sociale et institutionnelle à la nécessité d’une régulation démocratique du changement scientifique et technologique. Les études STS constituent un champ de travail dans les milieux académique, de l’éducation et la politique publique dont l’objet est de comprendre les aspects sociaux des phénomènes scientifique-technologiques, tant en ce qui trait à leurs déterminants sociaux qu’à leurs conséquences sociales et environnementales.
[3] Livre devenu un classique incontournable sur les études féministes des sciences et récompensé en 1987 par le prix Jessie Bernard de l’Association Américaine de Sociologie.
[4] Mary Jo Deegan réunit dans son livre les biographies de femmes sociologues de 1840 à 1990.
[5] Ainsi, afin d’apprécier l’influence du féminisme dans la discipline, j’ai comptabilisé les articles des revues (N=2.461), de leur année de fondation à 2005, comportant dans leur corps de texte, les notes ou les références les mots-clés suivants : gender, feminism et feminist. J’ai pu procéder de la sorte grâce aux bases de données comme JSTOR qui hébergent les articles des trois revues, à l’exception des cinq dernières années pour lesquelles j’ai utilisé les bases de données MUSE et SAGE. Des résultats ainsi obtenus, ont été éliminés les recensions de livres, les commentaires ainsi que les lettres de moins de cinq pages.